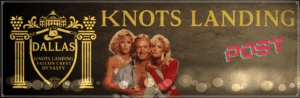Cet article est une traduction fidèle de l’interview menée par Guido Blanco publiée le 18 novembre 2025 sur son site https://www.guidoblanco.com.ar/
Pour voir l’article dans sa version originale en espagnol.
Une conversation qui aborde Falcon Crest, Bette Davis, l’activisme contre le sida dans les années 80, son statut de sex-symbol, son travail avec Matthew Perry sur Friends, Flamingo Road et son nouveau podcast 2 Bitches from Texas.

Vous avez commencé à travailler au théâtre à l’âge de 10 ans. Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers pas ?
J’étais une enfant très timide, le genre d’élève que les professeurs adorent. J’avais d’excellentes notes et je ne disais jamais un mot. Mais un jour, une des enseignantes a décidé que nous devions faire des exposés oraux au lieu d’écrits. Et je suis restée plantée devant la classe pendant trois jours, sans parvenir à prononcer un seul mot. Ma mère a décidé qu’aucun de ses enfants ne serait à ce point paralysé, alors elle nous a inscrites, ma sœur et moi, à des cours de théâtre. Ma sœur adorait ça. Tous les samedis, elle était tellement excitée d’y aller, et moi, je courais aux toilettes pour vomir (rires). J’étais terrifiée. Mais à la fin de l’année, un samedi matin, ma mère lisait le journal et a dit : « Oh, la troupe de théâtre Junior Players Guild organise des auditions. » Et la Junior Players Guild était une très bonne troupe de théâtre pour enfants à Dallas, et ils montaient d’excellentes productions.
Vous avez passé une audition ?
On est restés assis au fond de l’auditorium toute la journée, à attendre et à regarder les autres enfants faire des petites improvisations. Et puis, on se disait : « Je pourrais faire mieux, mais hors de question que j’y aille » (rires). Finalement, ma mère a dit que c’était presque la fin. Et ma sœur a dit : « Je veux passer l’audition. » Je savais que si je n’y allais pas, ma mère allait me harceler tout le long du chemin du retour. Alors on a auditionné, et un monsieur très gentil nous a donné à toutes les deux de petits rôles. Franchement, s’ils ne m’avaient rien donné du premier coup, je ne sais pas si j’aurais eu le courage d’y retourner. Mais je dis toujours que si j’ai une carrière aujourd’hui, c’est parce que ma peur de la scène n’était surpassée que par ma peur de ma mère (rires).
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?
Voilà toute la différence qu’un adulte peut faire dans la vie d’un enfant : lui donner cette chance, ce petit coup de pouce en confiance, en lui disant : « Je crois que tu peux faire cette chose que tu penses impossible. » Ça compte énormément quand on est enfant. Ça compte toujours, mais quand on est enfant, ça compte vraiment beaucoup.
En 1967, vous avez fait votre premier film, Bonnie et Clyde , en tant que doublure cascadeuse. Quelles scènes avez-vous dû remplacer Faye Dunaway ?
Oh là là ! Tellement souvent ! Dès que je suis assez loin, en silhouette, ou que c’est l’arrière d’une tête, c’est probablement moi. Il y a une scène qui a fait beaucoup rire au cinéma, celle où ils s’échappent après un braquage de banque. Et, de dos, ils filment au moment où ils s’approchent d’un camion rempli de poulets et manquent de le percuter. Si vous regardez la fille, c’est l’arrière de ma tête. Et vous pouvez voir que mes cheveux sont d’une nuance de blond différente et plus longs que ceux de Faye. Mais vous ne me regardez pas. Vous regardez les poulets (rires).
En 1978, vous avez créé le rôle de Jenna Wade dans un épisode de la série à succès Dallas . À cette époque, a-t-on envisagé de développer votre personnage et de vous intégrer à la distribution régulière ?
À ce moment-là, non. La série n’avait même pas encore été diffusée lors du tournage, donc personne ne se doutait de son immense succès. Plus tard, on m’a proposé de revenir après l’annulation de Flamingo Road . Mais j’avais alors un contrat de développement avec un partenaire pour produire ma propre série, j’ai donc refusé. Si j’avais su qu’elle durerait aussi longtemps, j’aurais peut-être accepté.
Compte tenu du succès rencontré par le rôle par la suite grâce à l’interprétation de Priscilla Presley, vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait pu se passer si vous aviez continué à l’interpréter ?
Non, pas du tout. Vous savez, quand on gagne sa vie comme moi, en tant qu’actrice, ça ne sert à rien de se retourner sur le passé et de se dire : « Et si… ? » Ça vous ronge. Mais dans ce cas précis, j’ai pris cette décision parce que j’avais un partenaire avec qui j’écrivais un scénario. On tournait un pilote dans lequel je devais jouer, mais que je devais aussi produire ; j’aurais donc été propriétaire de ma propre série. Ça ne s’est pas fait, mais je ne le savais pas à l’époque. Il faut aussi prendre en compte qu’aux États-Unis, la durée de vie d’une série est généralement d’environ sept ans, et Dallas approchait déjà de cette limite, je crois. Alors on se demande : « Combien de temps cette série va-t-elle encore durer ? » Mais qui pouvait le savoir ? (rires)
Votre rôle mémorable dans Flamingo Road incarnait tous les traits d’un sex-symbol , une étiquette qui vous a été collée d’innombrables fois au fil des ans. Êtes-vous à l’aise avec cette description, ou avez-vous l’impression qu’elle vous enferme dans un stéréotype ?
Certes, il y a un certain risque d’être cataloguée, mais si l’on doit incarner quelque chose, autant être un sex-symbol. C’est mieux que d’autres rôles auxquels je peux penser. Mais oui, d’une certaine manière, jouer des femmes glamour m’a limitée, car le public ne m’imagine pas faire autre chose. Pourtant, en tant qu’actrice ayant grandi au théâtre, je me vois bien dans d’autres rôles. Par exemple, enfant, je rêvais d’être médecin ou paléontologue, mais je doute qu’on m’ait envisagée pour Jurassic Park (rires). De plus, je viens d’une famille d’avocats, mais lorsqu’on m’a confié le rôle d’une avocate dans Falcon Crest , on m’a fait asseoir sur le bureau de mon client en lui demandant s’il voulait un café. J’ai dit : « Ce n’est pas comme ça qu’ils travaillent. » Je me devais de défendre les droits des femmes et d’empêcher qu’on ne dépeigne les avocats comme des imbéciles.
Avez-vous des anecdotes à partager sur le tournage de Flamingo Road ?
Eh bien, une anecdote dont je me souviens très bien, c’est qu’après avoir terminé le pilote de deux heures, nous tournions le premier épisode, celui où mon mari, Mark Harmon, et moi étions kidnappés en mer. Ils nous ont ensuite mis dans un bateau et nous ont laissés dériver. Nous tournions dans l’océan Pacifique, à l’époque où les effets spéciaux numériques n’existaient pas encore. L’hélicoptère était juste au-dessus de nous et le bateau prenait l’eau. J’écopais et Harmon était allongé, car il était censé avoir reçu une balle. Je lui ai dit : « Mark, écope ! » Il a répondu : « Non, je suis blessé. » J’ai insisté : « Tu vas te noyer si tu n’écopes pas, chéri. Écope, parce qu’on coule ! » (Rires)
Comment se sont-ils sortis de cette situation ?
Je faisais des signes à l’hélicoptère, je leur disais qu’on était vraiment en danger, je les suppliais de venir nous chercher. Finalement, ils ont descendu une échelle de corde et nous ont laissé remonter en sécurité. Mais honnêtement, j’ai commencé à m’inquiéter parce qu’on était très loin du rivage. C’est un peu effrayant, en plein territoire des grands requins blancs. On n’a pas envie de couler.
La série s’est terminée sur une fin ouverte. Une troisième saison était-elle prévue ?
On était sûrs d’avoir une troisième saison, mais un nouveau dirigeant a pris la direction de la chaîne et nous a tout simplement annulés du jour au lendemain. J’ai acheté une maison, John Beck aussi – femme et quatre enfants. On attendait tous le renouvellement de nos contrats pour acheter. Je me souviens, j’étais en limousine, en route pour l’aéroport, direction New York pour la promo de la nouvelle saison, quand j’ai reçu un appel d’ Entertainment Tonight : « Alors, ça fait quoi d’apprendre que la série est annulée ? » Le nouveau dirigeant avait décidé qu’il ne voulait pas de notre feuilleton sur sa chaîne, même si on cartonnait sur NBC avant Bill Cosby. On était tous sous le choc, mais ça n’a pas aidé à payer les mensualités des maisons (rires).
Lors de la deuxième saison de Flamingo Road , le film The Seduction , dans lequel vous teniez votre premier rôle principal au cinéma, a été diffusé pour la première fois. Quels souvenirs gardez-vous de votre scène d’amour dans le jacuzzi avec Michael Sarrazin ?
Eh bien, tout d’abord, Michael Sarrazin était un acteur absolument charmant, merveilleux et gentil, et il est mort bien trop jeune. C’était un vrai plaisir de travailler avec lui, un homme très timide et discret. Ce dont je me souviens surtout, c’est que nous avons tourné pendant des heures et des heures, et qu’il y avait tellement de chlore dans le jacuzzi. Ma peau était tellement brûlée à la fin de la nuit que j’avais l’impression d’être dans une piscine d’acide. Elle a pelé pendant des jours. C’est le genre de chose qui paraît torride, sensuelle et très sexy, mais en même temps, intérieurement, on est en train de mourir. On se dit : « C’est du cinéma, c’est du cinéma. » (rires)
Une rumeur court selon laquelle Bette Davis aurait été tellement impressionnée par votre prestation qu’elle vous aurait envoyé une lettre de félicitations. Est-ce vrai ?
Non, ce n’est pas vrai. Natalie Wood m’a envoyé une lettre pour me féliciter pour Flamingo Road . J’avais travaillé avec elle un an auparavant et nous étions devenues de bonnes amies. Elle m’a donc écrit pour me féliciter d’avoir décroché le rôle, et je l’ai rappelée en lui disant : « Devine qui est notre concurrent ? Les Harts ! » Tu sais, la série de son mari (rires).
En 1983, vous avez eu l’occasion de travailler avec Bette Davis sur l’épisode pilote de la série Hotel . Comment était-ce de travailler aux côtés d’une actrice de son envergure ?
Bette était incroyable et si gentille avec moi. Je voulais vraiment le pilote car j’allais avoir des scènes avec elle. De plus, c’était un film de deux heures, comme on en faisait à l’époque. On m’avait prévenue qu’elle n’aimait pas travailler avec des femmes. Elle arrivait toujours très tôt et criait à l’équipe : « Qu’est-ce qu’on attend ? » Alors je suis arrivée sur le plateau. On tournait dans une magnifique demeure à Hancock Park, un peu comme Beverly Hills dans les années 20, où les anciennes stars de cinéma avaient leurs propriétés. Ma loge s’est perdue, avec tous mes costumes, mon maquillage et tout le reste. Je me suis assise sur la pelouse devant cette grande maison, sachant que Bette Davis m’attendrait, car je n’avais pas pu me préparer.
Comment as-tu surmonté ce moment ?
J’étais au bord de la crise de nerfs et j’avais le cœur qui battait la chamade. Heureusement, au début de la scène, je n’y figurais pas, alors elle et James Brolin ont filmé ce qu’ils pouvaient sans moi. Finalement, la loge est arrivée. Je me suis maquillée, j’ai pris toutes mes affaires et je me suis précipitée à l’intérieur. Elaine Rich, la productrice, m’a demandé : « Avez-vous rencontré Mlle Davis ? » Et j’ai répondu : « Eh bien, non, pas vraiment », car j’avais pourtant assisté à quelques dîners de gala où elle était à la même table et où l’on nous avait présentées, mais elle ne m’avait jamais adressé la parole. Puis, cette année-là, j’ai remis un Oscar, et pendant que j’attendais en coulisses, elle était à environ soixante centimètres de moi, en train de fumer cigarette sur cigarette, mais elle ne m’a toujours pas parlé. Bref, j’ai dit que je ne l’avais pas rencontrée, et elle a répondu : « Eh bien, venez la rencontrer. »
Comment s’est déroulée cette rencontre ?
Nous nous sommes approchées, et Elaine a dit : « Mademoiselle Davis, voici Morgan Fairchild. » J’ai répondu : « Oh, enchantée de vous rencontrer. » Elle a répondu : « Nous nous sommes rencontrées aux Valentino Awards. » C’était l’un des dîners où j’étais assise à côté d’elle. J’ai dit : « Eh bien, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que vous vous en souviendriez. » Puis elle a répondu : « Et j’ai quelque chose à vous dire. » J’ai dégluti et j’ai dit : « Oui, madame. » Un silence de mort s’est abattu sur la salle – on aurait pu entendre une mouche voler. Finalement, elle a dit : « Vous êtes formidable », et a ajouté : « Et une dernière chose… » avant de se lancer dans un énumération de tout ce que j’avais fait à l’écran : des choses obscures, des petits rôles. Finalement, j’ai dit : « Mademoiselle Davis, vous êtes très gentille, mais ce n’était pas un bon film. » Elle a répondu : « Eh bien, j’ai vu ce que vous essayiez de faire. » Alors, d’une certaine manière, elle m’a adoptée.
Finalement, la rencontre s’est avérée étonnamment agréable. Comment s’est déroulé le reste de cette journée de tournage ?
Vous savez, j’étais allée déposer mes affaires, et la productrice est arrivée et m’a dit : « Je ne peux pas avoir un simple « bonjour » et vous un « merveilleux » ? » (rires) Bref, elle m’a suivie toute la journée. Elle a dit : « Je n’ai jamais fait de série. À quoi dois-je m’attendre de ces types ? » Alors je lui ai raconté quelques-unes de mes batailles avec les chaînes. Elle a dit : « C’est ce que j’aime chez vous. Vous me rappelez moi-même quand je tenais tête à Jack Warner. » J’ai répondu : « Eh bien non, mademoiselle Davis. Quand vous avez tenu tête à Jack Warner, vous avez changé l’industrie. » Je veux dire, les gens peuvent vérifier – c’est historiquement vrai qu’elle a changé l’industrie. Autre chose amusante : elle était très menue, elle a levé les yeux vers moi et m’a demandé : « Vous mesurez combien ? » J’ai dit : « 1,63 m. » Elle a dit : « Moi aussi. » Et j’ai pensé : « Peut-être un jour » (rires). Mais elle était adorable.
Avez vous gardé le contact au fil des ans ou votre relation s’est-elle limitée au tournage de cet épisode ?
Oui. Elle m’appelait souvent pour discuter. Je me souviens qu’une fois, elle et James Stewart avaient tourné un film pour HBO sur un couple de personnes âgées qui avaient conclu un pacte de suicide. Elle m’a appelée et m’a dit : « Ils veulent que j’aille à une projection à la Directors Guild, et je dois y être. Je ne sais pas quoi dire. Et s’ils n’aiment pas ? Tu peux me raccompagner ? » J’ai répondu : « Bien sûr. » À l’époque, je sortais avec Johnny Carson, alors j’ai dit : « Johnny, il faut absolument qu’on aille à la projection de Bette à la DGA. » On est entrés, et je cherchais du regard… Le hall était bondé, et je ne voyais personne, mais Bette est plutôt petite. Je me suis dit qu’elle devait bien être quelque part. Finalement, un groupe d’hommes s’est écarté un peu, et je l’ai aperçue.
Était-elle toujours inquiète à l’idée de devoir être là ?
Elle me disait : « Oh, Morgan, merci mon Dieu que tu sois venu. Bonjour, Johnny. Bon, qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Vous devez tous rester assis là et regarder. Je dois rester jusqu’à la fin. Et après, tout le monde va passer devant moi sans s’arrêter. Et s’ils n’aiment pas le film ? » Vous savez, j’étais sidéré que Bette Davis puisse s’énerver pour un rien. Je lui ai dit : « Bette, écoute. Johnny et moi, on va rester ici avec toi. Si quelqu’un veut te dire un mot gentil, il te dira un mot gentil, mais tu n’es pas obligée de dire quoi que ce soit. Tu n’es pas obligée de parler à qui que ce soit si tu n’en as pas envie. On sera là avec toi pendant que tout le monde part, comme ça tu auras quelqu’un à qui parler. » Et c’est ce qu’on a fait. Bien sûr, tout le monde a adoré, et elle était brillante, comme toujours. Elle et Jimmy Stewart… comment aurait-on pu se tromper ?
Vous aviez une si belle relation avec elle, n’est-ce pas ?
Oh, elle était merveilleuse. Bon, je ne sais pas si les gens de votre pays connaissent Johnny Carson, mais il a été le présentateur de talk-show de fin de soirée le plus important ici pendant des décennies. J’ai fini par le quitter, et je n’en ai jamais parlé aux tabloïds ; je n’ai pas dit un mot. Mais après notre rupture, j’étais sûre que tout le monde pensait : « Oh, il a largué la petite blonde. » Bref, j’étais à un grand gala au Beverly Hilton, et il y avait plein de célébrités hollywoodiennes. J’ai senti une tape sur l’épaule, je me suis retournée, et c’était Bette. Elle s’est penchée vers moi et m’a dit : « Tu as bien fait de le quitter » (rires). Elle savait.
Au milieu des années 1980, vous avez incarné l’avocate Jordan Roberts dans la cinquième saison de Falcon Crest . Qu’avez-vous ressenti en donnant vie à un personnage aussi complexe, souffrant de ce qu’on appelait alors le trouble dissociatif de l’identité, suite à des années de maltraitance durant son enfance ?
Eh bien, cela m’intéressait beaucoup car, à cette époque, aux États-Unis, un film intitulé « Something About Amelia » était sorti , traitant de l’inceste infantile. Mais on n’avait jamais abordé auparavant son impact sur la vie adulte. Et aujourd’hui, il est bien établi que l’un des problèmes peut être ce qu’on appelait autrefois le trouble dissociatif de l’identité : pour faire face au traumatisme, le cerveau se divise en différentes « personnalités ». C’était un défi de taille que de m’attaquer à ce sujet et d’essayer de le dramatiser, car j’aime toujours faire des choses iconoclastes, vous savez, des choses que les gens n’ont jamais vues, ou qu’ils ne m’ont jamais vu faire. J’aime sortir des sentiers battus. Mais même là, ils ne voulaient toujours pas que ce soit écrit et me faisaient simplement asseoir au bureau de mon client pour lui demander s’il voulait un café.
Comment avez-vous géré cette situation très désagréable ?
J’étais frustrée parce qu’on m’avait proposé un rôle croustillant, et maintenant ils semblaient un peu intimidés. D’habitude, je portais mes propres vêtements sur ces plateaux, du genre Donna Karan et de gros bijoux des années 80. Je me souviens d’un jour où je quittais le plateau et un des producteurs sortait de la salle de visionnage des rushes. Il m’a dit : « Tu sais, Morgan, on n’arrêtait pas de dire : « Morgan porte encore ces énormes créoles ! » Tu pourrais peut-être essayer des perles ou quelque chose comme ça. » Je l’ai regardé et j’ai répondu : « John, écoute-moi bien : donne-moi une histoire et je porterai des perles. Mais quand je n’ai rien à faire, je vais mettre de l’ambiance. Je n’aurai peut-être pas d’histoire, mais, mon Dieu, demain matin, toutes les femmes d’Amérique se diront : « Tu as vu les créoles que portait Morgan Fairchild hier soir ? » » (rires)
Vous ont-ils enfin donné l’histoire que vous attendiez avec tant d’impatience ?
Oui, j’ai enfin décroché le rôle, et j’ai dû faire énormément de recherches. C’était une expérience traumatisante. J’étais tellement reconnaissante qu’ils aient engagé John McMartin, un merveilleux acteur de Broadway, pour jouer mon père – que j’avais adoré dans Follies – c’était formidable de pouvoir travailler avec lui au lieu de simplement rester dans la salle à le regarder. Et Jane Wyman était merveilleuse, vous savez, encore une fois, une actrice plus âgée. Jane et Bette m’ont dit quelque chose d’intéressant, car elles m’appréciaient toutes les deux et avaient la réputation de ne pas s’entendre avec les jeunes actrices. Elle m’a dit : « Tu sais, tu es tellement professionnelle. Tu es très à l’ancienne, comme nous. Tu es à l’heure, tu connais ton texte, tu fais tes devoirs. Et beaucoup de jeunes d’aujourd’hui sont si difficiles à gérer. »
Quel effet cela vous a-t-il fait d’être validée par une légende comme elle ?
Il y avait un grand respect de la part de l’ancienne génération, qui avait le sentiment de passer le flambeau, et j’ai vraiment apprécié cela. Je me souviens du premier jour où je l’ai vue sur le plateau. Je jouais l’avocate de David Selby, et il était à l’hôpital pour une raison ou une autre. Bref, on répétait pour déterminer le placement des caméras et la disposition des acteurs. J’avais une scène avec David, et au moment où je sortais, Jane est arrivée. J’ai fait une remarque amusante. Au début, personne n’a ri, mais ensuite Jane a ri, et tout le monde a ri aussi. Quelqu’un m’a interpellé et m’a dit : « Personne ne t’a jamais dit : « Ne fais pas de blagues quand Jane est sur le plateau » ? » Et j’ai répondu : « Non. Mais elle a ri. » (rires) Par contre, on m’a dit une chose : ne jamais mentionner Ronald Reagan.
Était-ce encore un sujet sensible pour elle, même après tant d’années depuis son divorce ?
Eh bien, c’est ce qu’ils m’ont dit. Et j’ai répondu : « Je suis bien élevée. Je ne vais pas parler de mon ex-mari. » Ma mère ne m’a pas élevée comme ça, vous savez. Mais un jour, nous étions assis sur le plateau, dans nos chaises de réalisateur. Je ne me souviens plus pourquoi, on avait une scène de grande fête, mais on était tous emmitouflés parce que c’était l’hiver et la grande porte du plateau était ouverte. Soudain, elle s’est penchée vers moi et m’a dit : « Est-ce que je t’ai déjà raconté des histoires sur Ronnie ? » Et j’ai répondu : « Eh bien, non. » (rires) Elle était vraiment adorable. Je me souviens d’un jour où je suis arrivée pour tourner une autre scène de fête, et Lorimar ne voulait pas nous donner d’argent – leur budget costumes était vraiment très serré. Du coup, si on voulait être bien habillé, il fallait porter ses propres vêtements.
Qu’est-ce que tu portais à ce moment-là ?
Je suis arrivée vêtue d’une tenue de Jean-Claude Jitrois, le créateur de cuir le plus en vogue de Rodeo Drive à l’époque. Je portais une veste en cuir rouge à épaulettes imposantes, une minijupe en cuir rouge et mes gros bijoux. Je suis entrée sur le plateau et quelqu’un m’a dit : « Oh, tu devrais aller te changer. Jane va détester ça. » J’ai répondu : « Eh bien, les gars, si j’avais un vrai budget costumes, j’aurais quelque chose à me mettre. Mais comme c’est ce que j’ai apporté, c’est ce que je dois porter. » À ce moment-là, Jane est arrivée, vêtue d’une robe trapèze et de perles, et m’a dévisagée de haut en bas en scrutant mes bijoux. Puis elle s’est approchée, m’a pris la main, a fait tinter un de mes gros bracelets et a dit : « Voilà ce qu’il faut à cette série. Un peu de paillettes, bon sang ! » (rires) J’avais donc l’approbation de Jane.
Avez-vous un souvenir ou une anecdote préférée avec elle ?
Mon anecdote préférée avec Jane Wyman, c’est lors du tournage dans la Napa Valley, pour toutes les scènes liées au vin et les plans extérieurs. Les acteurs logeaient au Silverado Country Club, tandis que l’équipe technique prenait un Holiday Inn plus proche de l’aéroport. Une fois, je ne devais tourner qu’une seule journée et je me suis dit : « Je vais dormir au Holiday Inn et arriver plus vite à l’aéroport le lendemain matin. » Mais j’ai attrapé une grippe carabinée ; j’ai été vraiment malade pendant deux ou trois jours. Je pouvais à peine bouger. Le deuxième jour, j’ai entendu frapper à la porte. J’ai supposé que c’était le personnel d’entretien et j’ai dit : « Oh, laissez juste quelques serviettes. » Je ne savais même pas si j’étais capable de traverser la pièce. Mais ils ont frappé de nouveau. Alors j’ai fini par me lever et ouvrir la porte.
Était-ce elle qui se tenait là ?
La voilà, cette petite femme, les cheveux tirés en chignon, portant un énorme bol de soupe poulet maison… et c’était Jane. Je l’ai à peine reconnue au premier abord ; je ne l’avais jamais vue sans sa perruque et son maquillage. Mais elle logeait toujours au Holiday Inn parce qu’elle n’aimait pas faire des allers-retours, alors elle s’y installait, car ils lui mettaient une grande cuisine à disposition et elle pouvait y rester toute la saison. Elle avait entendu dire que j’étais malade et était venue m’apporter sa soupe maison, qu’elle m’a livrée elle-même, presque méconnaissable sans tout le glamour et l’élégance qu’elle avait toujours. Et c’est mon anecdote préférée sur Jane Wyman : une femme vraiment adorable.
À peu près à la même époque, Jon Lovitz a créé le personnage de Tommy Flanagan, le menteur pathologique, pour l’émission Saturday Night Live . Son gag récurrent consistait à prétendre être marié à vous et vous avoir vue nue. Quelle a été votre réaction ?
Bon, d’habitude, je ne veillais pas aussi tard pour regarder Saturday Night Live . Bref, un lundi matin, je suis arrivé à Falcon Crest et quelqu’un m’a dit : « Oh, un type de SNL a fait une super blague sur toi. » J’ai demandé : « Ah bon ? C’était quoi ? » Et la personne a répondu : « Mon Dieu, je ne me souviens plus, mais c’était vraiment drôle. » Deux semaines plus tard, la même personne est revenue me voir et m’a dit la même chose, mais ne se souvenais toujours pas de la blague. Ça a duré un moment, puis la saison s’est terminée. Je ne l’avais toujours pas vu. À chaque fois que j’essayais de le regarder, il ne faisait rien sur moi, et je me demandais : « Mais de quoi parlent-ils ? » Puis, à l’automne, on a repris le tournage, et il recommençait. Et je me suis dit : « Bon, il faut que je fasse quelque chose pour ce type. »
Qu’avez-vous fait exactement ?
J’ai appelé son agent et j’ai eu son numéro de téléphone fixe. Je l’ai donc appelé et j’ai dit : « Salut Jon, c’est Morgan Fairchild. » Il a répondu : « Non, vraiment ? Qui est-ce ? » Je l’ai rassuré : « Non, vraiment, c’est Morgan Fairchild. » (rires) Il a dit : « Tu es fâchée ? » J’ai répondu : « Non, je trouve ça drôle. Je ne suis pas fâchée du tout. » Il venait d’être frappé par la même vague de célébrité que moi, alors je suis devenue un peu comme une grande sœur pour lui, l’aidant à gérer ce raz-de-marée. Il m’appelait et disait : « Ce type veut m’interviewer. Est-ce que je peux lui accorder l’interview ? » Et quand il a été nominé aux Emmy Awards, je l’ai appelé et je lui ai dit : « Tu sais, on ne s’est jamais vraiment rencontrés. Quand tu viendras aux Emmys, pourquoi ne t’inviterais-je pas à dîner ? » Il a dit : « Oui, super. »
Ce dîner a-t-il réellement eu lieu ?
Oui, c’est arrivé. Le lendemain soir, il était sur le tapis rouge des Emmy Awards, et on lui a demandé : « Alors, Jon, qu’as-tu fait à Los Angeles ? » Il a répondu : « Morgan Fairchild m’a invité à dîner. » Personne ne l’a cru. (Rires) Mais j’ai trouvé ça hilarant, et c’est un type adorable. Il m’a avoué que c’était lui qui avait inventé la blague, mais pour ce qui est du choix de l’actrice, c’est Al Franken qui a pensé à moi. Al Franken, qui travaillait au SNL et qui a ensuite été sénateur, est vraiment quelqu’un de formidable. C’est lui qui a suggéré Morgan Fairchild.
À propos de SNL , il y a une anecdote selon laquelle vous deviez animer l’émission en 1986, mais vous étiez en plein tournage de La Belle au bois dormant en Israël. Pouvez-vous nous dire ce qui s’est réellement passé ?
C’était vraiment bizarre. J’étais en Israël pour le tournage de La Belle au bois dormant et je parlais à ma mère au téléphone. Elle m’a dit : « Oh, je suis tellement contente ! Tu vas passer au Saturday Night Live ! » J’ai demandé : « C’est quand, au Saturday Night Live ? » Elle a répondu : « Ah oui, ce samedi. Je l’ai vu dans le guide télé . » J’ai dit : « Maman, c’est le Saturday Night Live et je suis en Israël. Je n’y suis pas ! » J’ai bien insisté sur le « en direct » (rires). J’ai suggéré : « C’est peut-être Morgan Brittany. » Elle a pris le guide télé et a dit : « Non, c’est toi ! » J’ai répondu : « Je n’en sais rien. » Et en effet, je n’en savais rien. J’étais en tournage à l’étranger, c’était donc impossible.
Mais avez-vous vraiment été embauché ?
Apparemment, un agent de mon agence, qui n’était pas mon agent habituel, m’a décroché le poste, sans rien dire à mon agent habituel, ni à moi, ni au directeur de l’agence, ni à personne d’autre. Je crois qu’il avait un petit problème de drogue, peut-être. Et voilà que je me retrouve dans le pétrin avec Lorne Michaels, qui pense que je lui ai posé un lapin, alors que ce n’est pas le cas. J’étais en Israël pour le tournage d’un film. Bref, ma seule chance de présenter le Saturday Night Live est tombée à l’eau. J’aurais adoré ; ça aurait été génial.
En 1992, vous avez joué dans trois épisodes de Roseanne , incarnant la petite amie bisexuelle du personnage interprété par Sandra Bernhard. Cette période est revenue sur le devant de la scène après l’apparition de Sandra dans l’émission d’Andy Cohen, où elle s’est excusée de ne pas vous avoir bien traitée pendant le tournage. Bien que tout soit désormais apaisé, que s’est-il passé à l’époque et qu’est-ce qui vous a amenée à accepter ses excuses ?
Eh bien, tout d’abord, j’accepterais toujours les excuses de quelqu’un qui regrette sincèrement ce qui s’est passé. Je ne sais pas, car je ne lui ai jamais parlé. Elle a fait beaucoup de choses en ligne, mais elle ne m’a jamais appelée, donc je ne sais pas exactement ce qu’elle a pensé avoir mal fait. Elles n’ont pas été très aimables avec moi ; elles n’étaient pas très accueillantes, elle et Roseanne. Tous les autres étaient super. Mais je ne me souviens pas qu’elles m’aient fait quoi que ce soit de précis ; c’était juste ce sentiment de « j’aurais préféré que tu ne sois pas là ». Un jour, peut-être qu’on en parlera et je comprendrai ce qu’elle voulait dire. Mais j’ai toujours pensé que si quelqu’un estime vous devoir des excuses, même si vous n’êtes pas tout à fait sûr de la raison, il faut les accepter de bonne foi.
Pourquoi avoir décidé d’interpréter un personnage LGBT au début des années 1990, compte tenu de l’homophobie et de la stigmatisation qui étaient si répandues à l’époque ?
Vous savez, j’ai beaucoup travaillé dans le domaine de la lutte contre le sida dans les années 80. J’ai collaboré avec le Dr Fauci, témoigné devant le Congrès pour lever des fonds, participé au lancement de notre première couverture commémorative du sida, inauguré le premier service hospitalier pour vétérans atteints du sida à New York et réalisé de nombreuses émissions spéciales pour la télévision. J’ai toujours œuvré pour que la communauté gay et lesbienne soit acceptée comme tout le monde ; vous savez, nous sommes tous des êtres humains. J’ai commencé le théâtre à 10 ans. Mes amis étaient toujours des personnes LGBTQ+ ; j’avais l’impression que tous ceux que je connaissais étaient gays ou lesbiennes. J’ai donc été témoin de nombreuses façons dont ils étaient traités, parfois maltraités.
Y a-t-il eu d’autres facteurs clés qui vous ont amené à accepter ce rôle en particulier, outre votre soutien à la communauté LGBT ?
Tout le scénario tournait autour de Sandra qui parlait de sa nouvelle copine canon. À la fin du premier épisode, elle ouvre la porte et je suis là. Vu que, comme tu l’as dit, je suis un peu un sex-symbol , j’ai trouvé ça hilarant que ce soit Morgan Fairchild qui soit là. Comme je l’ai dit, j’aime faire des choses inattendues, mais j’aime aussi défendre les droits des personnes LGBTQ+. Je pouvais donc faire d’une pierre deux coups : faire quelque chose d’iconoclaste et contribuer à déstigmatiser la communauté LGBTQ+. Et puis, bien sûr, mon avocat m’a demandé si j’étais gay, et j’ai répondu : « Non » (rires). Mais je défendrai toujours les personnes LGBTQ+.
À propos du sida, que vous venez d’évoquer, vous avez dit à plusieurs reprises que votre militantisme et votre travail auprès des patients vous ont coûté des emplois et des amitiés. Pouvez-vous nous parler de cette période ?
Eh bien, j’ai des passe-temps assez particuliers, et l’un d’eux est l’étude des virus émergents et de l’épidémiologie. Alors, quand le SIDA est apparu, je savais déjà de quoi il s’agissait, car je suivais l’évolution de la situation : il y a d’abord eu un petit article dans le New York Times sur des personnes atteintes du sarcome de Kaposi, un cancer qui ne touche que les hommes âgés d’origine méditerranéenne – on en comptait environ 11 à New York ; puis, il y a eu des cas groupés – 13, pour être exact – de pneumonie à Pneumocystis à San Francisco. Ensuite, on a appris qu’il s’agissait d’hommes homosexuels, et j’ai compris que quelque chose de nouveau se passait. Alors, tout ce que je trouvais qui me semblait pertinent, je le lisais. Et puis, j’ai accompagné Rock Hudson à une cérémonie de remise de prix pour l’ensemble de sa carrière.
Quand exactement ?
C’était quelques mois avant son arrivée dans Dynasty , peut-être neuf mois. Je tournais Falcon Crest à l’époque, et une rumeur circulait dans le studio : il n’avait pas bonne mine. J’ai tout de suite compris. Aux États-Unis, personne ne savait que Rock était gay, mais tout Hollywood le savait. Bref, j’ai commencé à donner des interviews pour parler du sida. Du vivant de Rock, ils organisaient un grand dîner de collecte de fonds. Plus tard, c’est devenu le dîner de l’amfAR, mais l’amfAR n’existait pas encore. Rien n’existait à ce moment-là. Et puis, j’ai reçu un appel de Ted Koppel, le présentateur de Nightline , une émission d’information très importante aux États-Unis. Ted m’a dit : « J’ai entendu dire que vous en savez plus sur cette maladie que quiconque. »
Vous a-t-il invité à participer à l’émission ?
Il a dit : « Bon, ce soir, on organise une table ronde sur le sida. » Et j’ai pensé : « Super. Il faut déstigmatiser le sujet. » Et il a dit : « Ouais. On aura notre médecin, Marilyn Beck, la chroniqueuse mondaine… » Je savais qu’elle allait jouer la carte de la peur, parce que tout le monde était terrifié. À Los Angeles, où que vous alliez, les paparazzis vous accostaient dans la rue et vous demandaient : « Vous allez encore embrasser quelqu’un ? » Vous savez, après que Linda Evans ait embrassé The Rock. Et puis Ted a dit : « On a une grande star, mais il veut une émission unique et moi, je veux une table ronde. Et je ne sais pas comment dire ça… » J’ai dit : « Ted, s’il te plaît, arrête. Si tu arrives à avoir une grande star, tant mieux. Mais s’il se désiste, je le remplacerai avec plaisir. »
Que s’est-il passé ensuite ?
Je lui ai dit : « Ça ne me dérange pas d’être seule ; je suis ravie de participer à une table ronde. Ce n’est pas une question de moi, mais de la maladie. Et je travaille. » Ils allaient enregistrer l’événement. C’était une soirée de gala, et je n’avais pas ma robe. Alors j’ai dit : « Si cette star vous pose un lapin, prévenez-moi et on trouvera une solution. » Et bien sûr, la grande star lui a posé un lapin, alors ils sont allés chez moi et ma femme de ménage leur a donné ma robe, mes chaussures, tout. Je me suis changée en robe de soirée à l’arrière de la limousine, filant à toute allure sur l’autoroute vers le Biltmore, en centre-ville. Ils m’ont fait entrer, m’ont littéralement installée dans un placard à balais, ont recouvert le nettoyant Ajax et les serpillères d’une bâche, et me voilà assise avec ma première connexion satellite, cette petite oreillette dans l’oreille.
Quel est votre meilleur souvenir de cette expérience ?
Une petite caméra était braquée sur moi, mais je ne voyais rien d’autre. À un moment donné, Ted demande : « Est-ce qu’on peut l’attraper en embrassant ? » Je l’interromps : « Il n’y a aucune preuve qu’on puisse l’attraper en embrassant. Le virus auquel il ressemble le plus est l’hépatite B. Des études menées à San Francisco ont isolé l’hépatite B dans la salive, mais même là, rien ne prouve qu’elle se transmette de cette façon. » Ted demande alors au médecin : « C’est vrai ? » Et le médecin répond : « Non, ce n’est pas vrai. » Bon, je ne vais pas contredire un médecin à la télévision nationale. Bref, plus tard, le producteur m’a raconté qu’après la coupure de l’antenne, le médecin était tellement furieux qu’une blonde hollywoodienne se prenne pour une experte qu’ils ont fait des recherches pour vérifier ses dires.
Cela a-t-il mené à quelque chose ?
Le lendemain, tout le monde m’a appelée pour s’excuser, car mes recherches étaient plus à jour que celles du médecin. Et puis, je suis devenue la personne de référence sur le sida pour l’émission Nightline. Mais bon, j’ai des passe-temps un peu bizarres qui font passer les gens pour des fous, mais ils me permettent d’obtenir des informations que je juge importantes de partager avec le public, si j’ai le courage de le faire, en sachant que je vais perdre du travail et que, dans certains cas, ça me mettra au ban de la société. D’ailleurs, je crois que j’ai été virée d’une émission à cause de ça. Et des directeurs de casting m’ont confirmé que, quand mon nom était évoqué à cette époque, on disait : « Oh, elle est trop controversée avec toutes ces histoires de sida. »
Qu’est-ce qui vous a permis de tenir le coup face à tout cela ?
Je ressentais une obligation morale, car j’étais la seule personnalité connue, la seule femme glamour, le seul sex-symbol, capable d’expliquer ce qu’est un rétrovirus, comment il fonctionne, comment il se transmet et pourquoi il ne se transmet pas. Il fallait que je tente de déstigmatiser le VIH/sida au sein de la communauté gay, que cette maladie soit simplement considérée comme telle et que des fonds soient alloués à la recherche. Car à cette époque, j’entendais souvent des réactions réactionnaires dire : « Qu’ils crèvent. Je ne les aime pas. » C’est la chose la plus horrible qu’on puisse entendre. Je me souviens, lors d’une audition devant le Congrès, un élu du Sud m’a demandé : « Mademoiselle Fairchild, dites-moi : combien de mes électeurs hétérosexuels, chrétiens et pieux vont devoir affronter cette maladie ? »
Qu’avez-vous répondu ?
Je l’ai simplement regardé et j’ai dit : « Monsieur, c’est une maladie. Elle ne fait pas de distinction de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, de couleur, de race ou de circonscription. Vos électeurs seront touchés, car c’est une maladie, et nous devons la traiter comme telle. » Il n’a rien ajouté (rires). Mais, vous savez, c’était une période très difficile. J’ai perdu des amis. Les gens ne voulaient pas que je sois près de leurs enfants. Ils ne voulaient pas que je mange dans leur assiette. Je me souviens d’un de mes amis, qui travaillait pour un grand tabloïd, qui m’a appelé du vivant de Rock et m’a dit : « On veut faire un article intitulé « Hollywood contre le sida » avec une grande photo de célébrités. Ça te dirait de poser pour la photo ? » J’ai dit : « Bien sûr. » Il m’a rappelé deux semaines plus tard et m’a dit : « Je voulais juste te remercier. »
Pourquoi vous remerciait-il en particulier ?
Il m’a dit : « Tout le monde nous a dit non… » et cela inclut beaucoup de personnes aujourd’hui très connues pour leur militantisme contre le sida. Il a ajouté : « Tout le monde nous a dit non jusqu’à ce que tu dises oui, et ensuite tu as permis aux autres de dire oui aussi, et c’est comme ça qu’on a obtenu notre photo. » Et c’est en gros ce que j’ai ressenti comme étant mon rôle pendant une grande partie des années 80 : être en première ligne et encaisser les coups pour que les autres puissent me soutenir, prendre la parole et essayer d’obtenir des financements.
Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lors de vos premières visites à l’hôpital ?
Je me souviens du premier hôpital où je suis allée. J’étais tellement nerveuse ! Ces gens-là ne sont pas au mieux de leur forme, et que dire à une inconnue à l’hôpital ? Allais-je simplement entrer, saluer tout le monde et puis… ? Je suis entrée, et trois personnes ont accouru vers moi en me disant : « Morgan, on veut tes secrets de maquillage ! » Et je me suis dit : « Je peux faire ça. » (Rires) Apporter un peu de joie et de réconfort dans la vie des gens, leur montrer qu’on était là pour les prendre dans ses bras quand personne d’autre ne le faisait – je veux dire, avant la princesse Diana. Et surtout, leur faire sentir qu’ils étaient aimés, importants et réconfortés.
Pour changer légèrement de sujet, vous incarniez la mère de Chandler, le personnage interprété par Matthew Perry dans Friends . Quelle impression avez-vous eue de lui, et comment avez-vous réagi à l’annonce de son décès ?
Oh mon Dieu, Matthew était si adorable. C’était une véritable tragédie. C’était difficile d’être impliquée de loin et de le voir traverser cette épreuve, car il n’était pas toujours présent dans la série ; il venait et partait, et je ne pouvais pas vraiment l’aider. Bien sûr, nous pensions tous qu’il s’en était remis et que tout allait bien, et puis soudain, il est décédé. J’étais anéantie d’apprendre la nouvelle. Je me souviens encore du jour où on m’a proposé le rôle : la série n’était pas encore un grand succès, mais je l’avais vue et je pensais qu’elle avait du potentiel. Je trouvais que chacun des acteurs était vraiment bon individuellement, mais aussi qu’ils formaient un très bon groupe.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez été contacté au sujet de ce projet ?
Quand on m’a proposé le rôle, c’était la première fois que j’incarnais la mère d’un adulte. J’avais joué des mères d’enfants et d’adolescents, mais jamais une mère d’adulte. Et Cicely Tyson, une actrice formidable, m’a dit : « Oh, Morgan, tu es trop jeune pour jouer la mère de ce garçon. » Et j’ai répondu : « Eh bien, il faut bien faire cette transition à un moment donné. » J’aimais bien la série ; je la trouvais sympathique. Et j’ai cette théorie selon laquelle tous les cinq ans, il faut se présenter à nouveau à un public plus jeune, et cette série était destinée à un jeune public. Alors je me suis dit : « Je le ferai. »
Comment s’est passée votre première journée de tournage ? Comment avez-vous rencontré Matthew ?
Le premier jour de tournage, Matthew est arrivé en courant vers moi. C’était un grand garçon, mais avec un air de gros chiot. Il m’a dit : « Oh, tu ne te souviens sûrement pas de moi, mais j’étais avec toi sur le plateau de Falcon Crest avec mon père. » J’ai demandé : « Qui est ton père ? » Il a répondu : « John Bennett Perry. » Son père jouait régulièrement le rôle du shérif dans cette série. Je me suis dit : « Mon Dieu, c’était toi, ce petit garçon ! » Et je me suis dit : « Je suppose que je suis assez vieille pour jouer sa mère. » (Rires) J’ai donc ressenti une sorte d’affection maternelle pour lui, car je connaissais son père et je l’avais connu plus jeune. Cette première année a été très amusante, et la série est devenue un énorme succès.
Comment les choses ont-elles évolué à partir de là ?
Eh bien, j’étais l’une des premières guest stars de Friends , et je me souviens d’avoir croisé Matt LeBlanc et Matthew Perry dans un magasin Blockbuster. Ils sont venus vers moi en courant, m’ont pris dans leurs bras et m’ont dit : « Tu nous as mis dans le top cinq ! » J’avais l’impression d’avoir un peu contribué au succès de la série. Mais ensuite, à mon retour, j’ai commencé à entendre des rumeurs concernant des problèmes de drogue. Il allait toujours bien aux répétitions ; je ne m’en rendais pas vraiment compte, si ce n’est qu’il ne socialisait pas beaucoup. Il filait directement dans sa loge. Sur le plateau, honnêtement, je ne l’ai pas remarqué. Je ne sais pas si les autres, qui travaillaient plus régulièrement avec lui, l’ont vu ou non. Mais je me souviens qu’à un moment donné, après sa sortie de cure de désintoxication, son père, John, était sur le plateau, et nous avons longuement discuté.
Lui avez-vous donné des conseils ?
Eh bien, j’ai connu plusieurs hommes dans ma vie qui avaient des problèmes de drogue et d’alcool. À cette époque, j’étais impliquée depuis des décennies dans un groupe appelé Al-Anon. Al-Anon, c’est un peu comme les Alcooliques Anonymes, mais pour les familles des personnes toxicomanes. Ils nous apprennent à gérer la situation et à interagir de manière constructive avec ces personnes. J’ai donc essayé de l’encourager à faire de même. Je ne sais pas s’il l’a fait. Ensuite, forte de mon expérience, j’ai parlé à Matthew et je lui ai dit : « Je sais que tu sors tout juste de cure de désintoxication, et je suis dans ce programme depuis longtemps. Voici mon numéro. Appelle-moi si tu as besoin de parler de quoi que ce soit. » J’essayais de lui donner un conseil sérieux, une sorte d’électrochoc. Il ne m’a jamais appelée, et je le regrette. Mais ensuite, il a semblé aller mieux.
Aviez-vous le sentiment qu’il avait surmonté ces problèmes liés aux substances ?
Il semblait réussir sa vie. Il avait publié son livre et aidait des personnes aux prises avec des problèmes de drogue et d’alcool. Il avait aussi sa fondation. Son décès soudain a donc été un véritable choc, une tragédie, non seulement parce qu’un jeune acteur si prometteur est mort, mais aussi parce que c’était quelqu’un d’adorable. Un vrai amour, un garçon formidable. C’est comme ça que je me souviens de lui : accourant vers moi, tout énergique, sur le plateau ce premier jour.
Aujourd’hui, votre nouveau projet est un podcast intitulé 2 Bitches from Texas , que vous co-animez avec votre sœur, l’actrice Cathryn Hartt. Comment l’idée vous est-elle venue ?
L’idée nous est venue car nous sommes toutes les deux actrices et avons commencé le théâtre dès notre plus jeune âge. Elle, diplômée de Juilliard, enseigne maintenant l’art dramatique à Dallas et a reçu de nombreuses récompenses, notamment celle de Meilleure Coach d’Acteurs du Texas à plusieurs reprises, décernée par différents magazines spécialisés. Bref, pendant la pandémie de COVID, nous avons eu l’impression de perdre un peu le contact à cause du décalage horaire entre Los Angeles et Dallas. On a toujours peur d’appeler quand l’autre personne n’est pas disponible ou qu’on risque de couper la conversation. Alors, nous avons commencé à nous appeler chaque dimanche soir. Puis nous nous sommes demandé : « Que pourrions-nous faire ensemble ? » Depuis des années, nous rêvions de collaborer sur un projet.
Comment cela s’est-il traduit par l’idée de faire un podcast ?
Une de ses étudiantes avait déménagé en Italie, et Cathryn avait enregistré un épisode de podcast avec elle. Du coup, on n’avait pas besoin d’être dans la même pièce, comme maintenant. Et j’ai dit : « On pourrait faire un podcast. On pourrait le faire ensemble, un peu comme nos discussions du dimanche soir, où on parle de tout et de rien. » Voilà comment l’idée est née. Et bien sûr, il a fallu trouver un nom. Après avoir essayé plusieurs options, j’ai fini par dire : « Franchement, c’est juste deux Texanes qui papotent. » Et puis je me suis dit : « Tiens, c’est un bon nom. » (rires) Apparemment, il est facile à retenir. Les gens s’en souviennent.
Existe-t-il un thème commun ? Ciblent-ils un public spécifique ?
Il n’y a pas de thème particulier. J’ai des intérêts très variés, et c’est ce que nous faisons. Notre premier épisode était avec Donna Mills de la série Côte Ouest . Nous avons parlé de toutes sortes de choses, pas seulement d’Hollywood. Nous avons parlé de son adoption à 54 ans, de ses choix de vie et d’autres sujets. Ensuite, nous avons reçu mon ami Tom Nichols, spécialiste de la Russie, qui a enseigné pendant 25 ans au Naval War College et qui écrit maintenant pour The Atlantic – un homme très sérieux. Nous avons discuté avec lui de certains de ses livres et articles. Il a notamment écrit un livre intitulé « La Mort de l’Expertise » . Nous avons d’excellents retours. J’étais un peu inquiète de la réaction du public en passant de Donna à Tom, mais nous avons un public très diversifié, et beaucoup de gens s’exclament : « Oh là là, ce sont vraiment de bonnes idées ! »
Quel a été votre épisode le plus récent à ce jour ?
Le dernier épisode en date est avec Nic Suarez, un des élèves de ma sœur, influenceur suivi par 8,5 millions de personnes sur TikTok. Il a commencé par se transformer en vampire, une transformation qu’il a recréée sur le plateau. Bien sûr, ma première question a été : « C’est quoi un influenceur, au juste ? Et en quoi ça consiste ? » (rires) Son père apparaît aussi dans l’épisode puisqu’il participe à ses vidéos. On a beaucoup discuté, car son père est originaire du Costa Rica, et on voit bien à quel point le fils est heureux de pouvoir l’emmener en voyage. Maintenant qu’il est un influenceur aussi populaire, il l’emmène à Berlin, à Londres et dans plein d’autres endroits où il n’est jamais allé. Même si son père a l’air très moderne et cosmopolite, il y a encore beaucoup de lieux qu’il n’a pas visités.
Quels invités pouvons-nous attendre prochainement ?
On a un ami, Stephen Tobolowsky, un acteur de second rôle surtout connu pour Un jour sans fin , mais c’est le genre de visage qu’on a l’impression d’avoir déjà vu partout. Il y a aussi John Edward, le célèbre médium, qui a écrit un livre sur sa collaboration avec un agent du FBI, ayant contribué à résoudre de nombreuses affaires ces 25 dernières années. C’est intéressant, un peu comme une histoire vraie de crime avec une touche de parapsychologie. Linda Gray et Patrick Duffy, de Dallas, ont également confirmé leur présence, même si on ne les a pas encore filmés. Ce qui compte, c’est ce qui m’inspire ce jour-là : qui peut-on avoir ? Qui a des idées intéressantes ? Qui, parmi mes connaissances, a une histoire de vie fascinante et méconnue ? C’est ce qui s’est passé avec Donna, par exemple.
De quelle façon ?
J’ignorais totalement qu’elle était une si bonne femme d’affaires. J’ignorais qu’elle possédait un vignoble. J’ignorais qu’elle avait adopté à 54 ans. Ce n’est donc pas la norme ; cela dépend plutôt de l’influence de certains événements. La même chose est arrivée à Tom, un homme plutôt dur, très acerbe sur Twitter, avec une langue bien pendue. Mais je savais qu’il avait un chat qu’il adorait. Il raconte souvent qu’il traversait un divorce difficile et qu’il faisait la navette tous les jours pour aller travailler. Il passait devant une animalerie ou un refuge, et il y avait toujours un chat à la vitrine qui le regardait. Finalement, sur les conseils d’un ami, il l’a adopté. Le chat est devenu son compagnon, et il lui a attribué le mérite de l’avoir aidé à traverser cette période difficile. Il a même fini par écrire une chronique dans The Atlantic intitulée « Le chat qui m’a sauvé ».
Avez-vous d’autres projets personnels ou professionnels en tête pour un avenir proche, ou des objectifs particuliers que vous souhaitez atteindre ?
Pas pour le moment. C’est une période creuse à Hollywood à cause des fêtes : tout le monde part pour Thanksgiving et Noël, et ne revient qu’en février. Avant, ils revenaient après le 1er janvier, mais maintenant, ils vont tous à Sundance et ne reviennent qu’en février. Du coup, j’ai largement le temps de me consacrer au podcast.
Enfin, quel message final souhaiteriez-vous adresser à mon public, à mes lecteurs ?
Je voulais simplement vous remercier de votre écoute, de votre fidélité durant toutes ces années, et vous envoyer des encouragements. Vous savez, la situation est un peu étrange en Amérique en ce moment, mais beaucoup d’entre nous restent attachés à la bienveillance, essayons de tendre la main aux autres, de les aider, et de ne pas être des égoïstes. (Rires) Alors, je voulais simplement vous témoigner tout mon amour – à vous, mon public.
Guido Blanco est diplômé en journalisme de l’Université nationale de La Matanza (UNLaM). Originaire de Buenos Aires, il s’est forgé une solide réputation dans le journalisme culturel grâce à des interviews qui dépassent le simple échange de questions-réponses : il s’agit de conversations inspirantes, émouvantes et marquantes.
Il a eu le privilège de s’entretenir avec des figures emblématiques du cinéma, de la musique et de la télévision – des artistes récompensés ou nommés aux Oscars, aux Grammy Awards, aux Emmy Awards, aux Tony Awards et aux Golden Globes, et dont le nom figure sur le Hollywood Walk of Fame. Son style se caractérise par la profondeur, l’empathie et la perspicacité, avec une attention particulière portée à chaque étape du processus, de la recherche à la production, en passant par le montage et la traduction.
Son travail est nourri par un amour des classiques et une fascination pour la culture pop, queer et camp, mais surtout, il est animé par une curiosité insatiable : le désir de découvrir de nouvelles perspectives et de partager des histoires qui préservent la mémoire culturelle tout en créant des liens entre artistes, médias et publics. On peux retrouver ses entretiens sur son site.

Sur son site, vous trouverez également de nombreux autres entretiens avec des acteurs comme George Chakiris,
[email-subscribers-form id="1"]